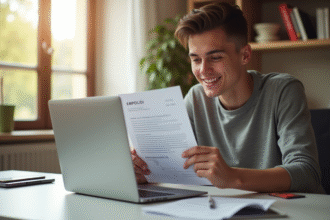Un événement vécu par une génération ne se transmet pas de la même façon d’une famille à l’autre. Des études récentes révèlent que certains traumatismes persistent au sein d’un groupe familial, tandis que d’autres franchissent les frontières du lien de filiation directe pour toucher des communautés entières sur plusieurs générations.
Des différences notables existent dans les mécanismes de transmission, les manifestations psychologiques et les stratégies de prévention. Comprendre ces distinctions permet d’envisager des réponses adaptées aux besoins des personnes concernées.
Traumatismes générationnels et intergénérationnels : de quoi parle-t-on vraiment ?
Aborder le traumatisme transgénérationnel ou intergénérationnel, c’est s’attaquer à la question de la transmission des blessures psychiques à travers le temps, d’adulte en enfant, parfois même jusqu’à façonner la mémoire d’une société. Un traumatisme générationnel surgit d’abord dans les replis d’une famille : choc, violence, exil ou secret, marqué dans la chair et les récits, relayé de parents à enfants. Ce concept, mis en lumière par Anne Ancelin Schützenberger, s’est imposé pour penser l’impact des secrets de famille, des silences autour de la violence domestique ou des histoires d’exils.
À l’inverse, le traumatisme intergénérationnel dépasse les frontières du foyer. Son empreinte s’étend sur plusieurs générations adjacentes, débordant parfois largement l’arbre généalogique, lorsque des catastrophes naturelles, des guerres ou des persécutions collectives frappent. Il s’agit alors d’un héritage partagé, intégré dans la mémoire d’un groupe, qui façonne en profondeur l’histoire d’une communauté ou d’un peuple.
Voici ce qui caractérise la transmission de ces traumatismes :
- Transmission des traumatismes : elle s’effectue par la parole, le silence, les comportements qui se répètent, et, selon certaines recherches, par des modifications épigénétiques qui pourraient laisser une empreinte biologique.
- Famille et société : la famille demeure une courroie de transmission de premier plan, mais certains traumatismes franchissent ce cercle pour se diffuser via l’école, les institutions, les récits sociaux et culturels.
La nuance entre transgénérationnel et intergénérationnel se loge dans l’ampleur et la circulation du traumatisme. D’un côté, l’intimité et la transmission souterraine, de l’autre, la mémoire collective et les cicatrices inscrites dans la culture d’un groupe. Comprendre ces mouvements, c’est saisir comment un événement survenu il y a des décennies peut continuer de colorer la vie des générations actuelles.
Qu’est-ce qui distingue un traumatisme générationnel d’un traumatisme intergénérationnel ?
Tout commence par la façon dont le traumatisme se transmet et à qui il s’adresse. Dans le cas du traumatisme générationnel, la blessure psychique se construit dans l’espace intime de la famille. Elle circule de parents à enfants, parfois sur plusieurs générations, glissant à travers les silences, les non-dits ou les schémas qui se répètent sans fin. La transmission se joue dans la proximité, tissée dans les gestes du quotidien, les paroles retenues et les secrets à demi-mots.
Le traumatisme intergénérationnel se distingue par son amplitude. Il s’infiltre dans la société entière, affectant plusieurs générations adjacentes au sein d’un même groupe. Quand une catastrophe naturelle, une guerre ou une persécution collective survient, l’expérience laisse une empreinte partagée, transformant la mémoire d’un peuple et se propageant par l’école, les institutions, les récits transmis en dehors du foyer.
Pour mieux cerner la différence, voici comment ces deux types de traumatismes s’expriment :
- Générationnel : transmission intime et familiale, vécue au plus près des enfants et parents, dans le cercle restreint du lien de sang.
- Intergénérationnel : impact collectif, transmission portée par la culture, l’éducation, les traditions et l’ensemble de la société.
Anne Ancelin Schützenberger, figure de la psychogénéalogie, a montré comment les traumatismes générationnels s’enracinent dans l’histoire personnelle, tandis que les traumatismes intergénérationnels se diffusent dans le tissu social tout entier. Approcher cette distinction, c’est ouvrir la voie à des prises en charge qui tiennent compte à la fois de l’individu et du groupe.
Des conséquences invisibles mais bien réelles sur les descendants
Les traumatismes générationnels et intergénérationnels s’invitent dans la vie des descendants sans laisser d’indices flagrants. Pourtant, ils se manifestent sous la forme d’anxiété persistante, de stress post-traumatique, de troubles du sommeil ou de comportements d’évitement, parfois même par des réactions intenses à des situations anodines. La souffrance ne disparaît pas avec ceux qui l’ont vécue en premier : elle s’infiltre, mute, continue de circuler dans les liens familiaux ou sociaux.
La transmission des traumatismes ne s’arrête pas à la parole ou au silence. Les avancées en épigénétique laissent penser que le corps lui-même pourrait retenir la trace des épreuves extrêmes, et la passer à la génération suivante. Les enfants de survivants à des drames collectifs présentent parfois des signes biologiques associés au syndrome de stress post-traumatique, même sans avoir connu eux-mêmes l’événement.
Voici quelques façons concrètes dont ces traumatismes se manifestent chez les descendants :
- Chez les enfants survivants, le choc se niche dans le corps : gestes figés, cauchemars à répétition, posture fermée.
- Dans les transmissions intergénérationnelles, le stress se propage par l’école, les récits collectifs, la culture, sculptant une mémoire partagée et des comportements communs.
La santé mentale des descendants dépend alors de la capacité de la famille et du groupe à donner sens à ce qui se rejoue. Là où le silence et le tabou dominent, les mêmes troubles psychiques se répètent, comme un appel à mettre des mots sur l’indicible.
Accompagner les personnes concernées : quelles pistes pour avancer ?
Lorsqu’il s’agit de traumatismes générationnels ou intergénérationnels, la route vers la réparation s’avère souvent sinueuse : silences, secrets, déni collectif. Pourtant, des approches thérapeutiques émergent et gagnent du terrain. La psychogénéalogie, développée par Anne Ancelin Schützenberger, invite à remonter le fil de l’histoire familiale, à débusquer les répétitions et les non-dits, pour relier les symptômes du présent à des événements enfouis. Ce travail d’exploration offre des clés pour comprendre ce qui se transmet et, parfois, ouvrir une brèche vers la réparation.
Parmi les outils les plus prometteurs, la thérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) occupe une place de choix. Grâce à des mouvements oculaires guidés, elle permet de retraiter les souvenirs traumatiques, même ceux hérités des générations précédentes. De nombreuses études cliniques soulignent son efficacité pour atténuer les troubles liés au syndrome de stress post-traumatique, qu’ils soient le fruit d’expériences vécues ou héritées.
Plusieurs actions concrètes peuvent accompagner les personnes concernées :
- Rétablir le dialogue familial, lever les secrets de famille, redonner à la parole sa juste place : tout cela participe à la résilience d’un groupe.
- Entourer enfants et parents touchés par la transmission des traumatismes nécessite une approche à plusieurs mains, réunissant psychologues, thérapeutes et parfois travailleurs sociaux.
Reconnaître la blessure, offrir des dispositifs adaptés, transformer la mémoire douloureuse en levier : la santé mentale s’invente à partir de là. Refuser le déni, honorer chaque histoire familiale dans sa singularité, c’est peut-être la première étape pour réinventer la suite. Et offrir, à celles et ceux qui portent l’héritage du passé, une chance d’écrire leur propre trajectoire.